Blog
ANSM : CONFLITS D’INTÉRÊTS ET CORRUPTION AU CŒUR DE L’AGENCE DU MÉDICAMENT
Enquête sur les zones d’ombre de l’ANSM : entre liens financiers avec l’industrie pharmaceutique, conflits d’intérêts systémiques et scandales sanitaires, l’Agence nationale de sécurité du médicament fait face à une crise de crédibilité majeure.
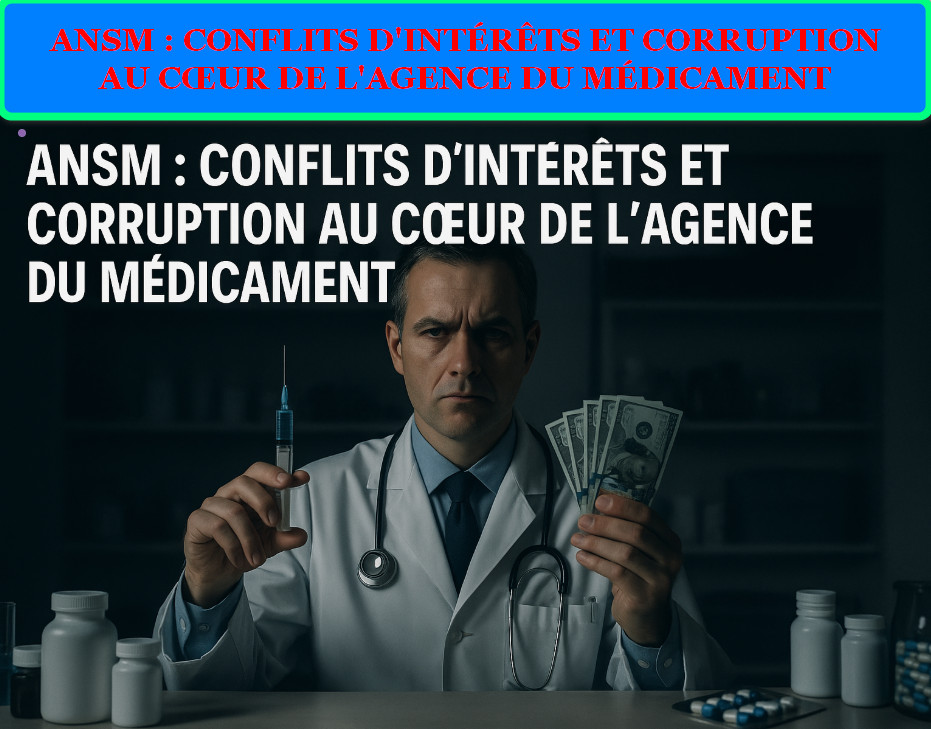
I. L’ANSM : Gardien de la Santé Publique ou Complice de l’Industrie ?

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), créée en 2012 pour succéder à l’Afssaps après le scandale du Mediator, devait incarner une nouvelle ère de transparence et d’indépendance dans la régulation pharmaceutique française. Pourtant, dix ans après sa création, l’agence fait face à des accusations récurrentes de conflits d’intérêts et de complaisance envers l’industrie pharmaceutique.
Avec un budget de 117,8 millions d’euros en 2023 et près de 1 100 agents, l’ANSM est chargée de l’évaluation des bénéfices et des risques des produits de santé avant leur mise sur le marché, ainsi que de leur surveillance continue. Cette mission cruciale pour la santé publique française est cependant compromise par des liens financiers et personnels étroits entre l’agence et l’industrie qu’elle est censée réguler.
Les révélations successives de médias d’investigation comme Le Canard Enchaîné, Mediapart ou Prescrire dessinent le portrait d’une institution publique où les intérêts privés s’immiscent dans les décisions de santé publique. Ces compromissions systémiques soulèvent des questions fondamentales sur l’indépendance réelle de l’agence française du médicament.
II. LES MÉCANISMES PERNICIEUX DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
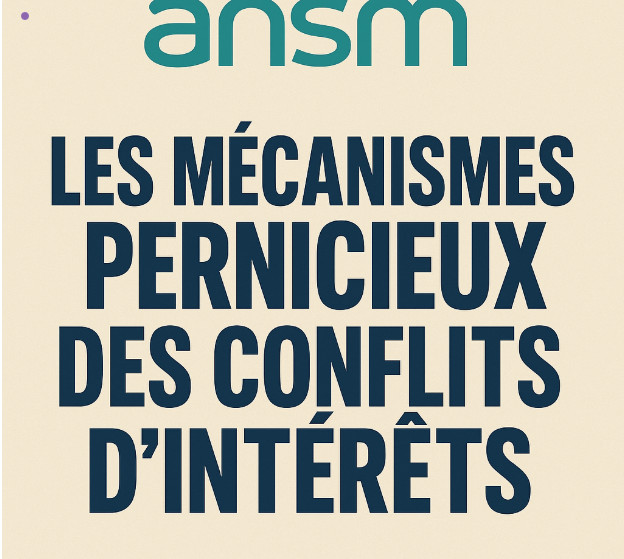
A. UN SYSTÈME DE LIENS FINANCIERS INSTITUTIONNALISÉ
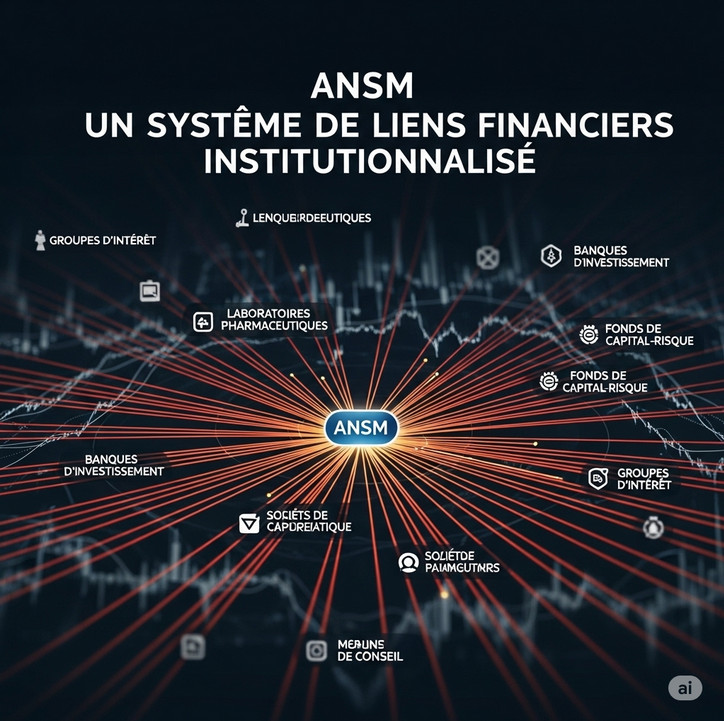
L’ANSM fonctionne selon un modèle qui institutionnalise les conflits d’intérêts. L’agence fait massivement appel à des experts externes pour évaluer les médicaments et dispositifs médicaux. Or, la grande majorité de ces experts entretiennent des liens financiers directs avec les laboratoires pharmaceutiques dont ils évaluent les produits.
En 2022, une étude de l’association Formindep révélait que 85% des experts siégeant dans les commissions de l’ANSM déclaraient des liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Ces liens prennent diverses formes : consultance, participation à des conseils scientifiques, financement de recherches, invitations à des congrès, ou encore détention d’actions.
CONFLITS D’INTÉRÊTS À L’ANSM (DONNÉES 2022) :
• 85% des experts déclarent des liens avec l’industrie
• 67% des présidents de commissions ont des conflits d’intérêts
• 156 millions d’euros de revenus déclarés par les experts en 2021
• 12% seulement des experts sont considérés comme « indépendants »
B. DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DÉFAILLANTES
Le système des déclarations publiques d’intérêts (DPI), censé garantir la transparence, révèle ses limites. De nombreux experts omettent de déclarer certains liens financiers, ou les minimisent dans leurs déclarations. L’ANSM ne dispose pas de moyens suffisants pour vérifier l’exhaustivité et la sincérité de ces déclarations.
Plus problématique encore, l’agence continue de faire appel à des experts présentant des conflits d’intérêts majeurs avec les dossiers qu’ils sont amenés à évaluer. Le principe de précaution, pourtant fondamental en matière de santé publique, cède souvent le pas aux contraintes pratiques et à la pénurie d’experts réellement indépendants.
C. LA CAPTURE RÉGLEMENTAIRE : QUAND L’INDUSTRIE DICTE LES RÈGLES
Le phénomène de « capture réglementaire » est particulièrement marqué à l’ANSM. L’industrie pharmaceutique influence directement les processus réglementaires par le biais de ses représentants dans les instances consultatives, de ses financements de recherche, et de ses relations privilégiées avec les hauts fonctionnaires de l’agence.
Cette capture se manifeste par des délais d’évaluation raccourcis pour certains médicaments à fort enjeu commercial, des autorisations de mise sur le marché accordées malgré des données d’efficacité limitées, ou encore des mesures de surveillance post-commercialisation insuffisantes.
III. L’AFFAIRE DU MEDIATOR : RÉVÉLATEUR D’UN SYSTÈME DÉFAILLANT
A. QUINZE ANS DE COMPLAISANCE COUPABLE
L’affaire du Mediator reste l’illustration la plus dramatique des défaillances de l’agence française du médicament. Commercialisé de 1976 à 2009, ce médicament du laboratoire Servier a causé entre 1 800 et 2 100 décès selon les estimations officielles, principalement par valvulopathies cardiaques et hypertension artérielle pulmonaire.
Pendant plus de quinze ans, l’Afssaps (puis l’ANSM) a maintenu l’autorisation de mise sur le marché du Mediator malgré les signaux d’alarme répétés. Les liens étroits entre l’agence et le laboratoire Servier expliquent en grande partie cette complaisance coupable qui a coûté la vie à des milliers de patients.
BILAN DE L’AFFAIRE MEDIATOR :
• 1976-2009 : 33 ans de commercialisation
• 1 800 à 2 100 décès estimés
• 5 millions de personnes exposées
• 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour Servier
B. LES LIENS COMPROMETTANTS AVEC SERVIER
L’enquête judiciaire sur l’affaire Mediator a révélé l’ampleur des liens financiers entre le laboratoire Servier et les experts de l’agence du médicament. Jean-Michel Alexandre, ancien directeur de l’évaluation des médicaments à l’Afssaps, percevait des honoraires de Servier tout en étant chargé de l’évaluation des médicaments du laboratoire.
Ces révélations ont conduit à la condamnation de plusieurs responsables de l’agence pour « tromperie aggravée » et « homicides et blessures involontaires ». Le procès du Mediator, qui s’est achevé en 2021, a établi la responsabilité pénale de l’État dans cette tragédie sanitaire.
C. DES RÉFORMES COSMÉTIQUES APRÈS LA CATASTROPHE
La création de l’ANSM en 2012 était censée tirer les leçons de l’affaire Mediator. Pourtant, les réformes entreprises se sont révélées largement cosmétiques. Si l’agence a renforcé ses dispositifs de déclaration des conflits d’intérêts, elle n’a pas fondamentalement remis en cause son modèle de fonctionnement basé sur l’expertise externe financée par l’industrie.
Dix ans après sa création, l’ANSM continue de s’appuyer massivement sur des experts présentant des conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Cette continuité dans les pratiques explique la persistance des scandales sanitaires et la défiance croissante du public envers l’agence du médicament.
IV. LE SCANDALE DES IMPLANTS PIP : QUAND L’ANSM FERME LES YEUX
A. VINGT ANS D’INSPECTION DÉFAILLANTE
L’affaire des implants mammaires PIP (Poly Implant Prothèse) constitue un autre exemple emblématique des défaillances de l’ANSM. Pendant près de vingt ans, la société PIP a commercialisé des implants mammaires remplis de gel de silicone industriel non médical, trompant ainsi les autorités sanitaires et exposant 300 000 femmes dans le monde à des risques sanitaires majeurs.
Les inspections de l’ANSM (ex-Afssaps) chez PIP étaient systématiquement annoncées à l’avance, permettant à l’entreprise de dissimuler ses pratiques frauduleuses. Cette complaisance dans les contrôles révèle une conception pour le moins accommodante de la surveillance des dispositifs médicaux.
B. DES SIGNALEMENTS IGNORÉS
Dès 2000, des chirurgiens plasticiens signalaient à l’agence du médicament des taux de rupture anormalement élevés des implants PIP. Ces alertes, qui auraient dû déclencher des investigations approfondies, ont été largement ignorées ou minimisées par les services de l’ANSM.
Il aura fallu attendre la faillite de PIP en 2010 et les révélations sur l’utilisation de gel industriel pour que l’agence réagisse enfin. Cette réaction tardive illustre parfaitement les dysfonctionnements de la surveillance post-commercialisation à l’ANSM.
BILAN DE L’AFFAIRE PIP :
• 300 000 femmes exposées dans le monde
• 30 000 femmes concernées en France
• 20 ans de commercialisation frauduleuse
• 500 millions d’euros de coût estimé pour la collectivité
C. UNE RESPONSABILITÉ ÉTABLIE MAIS NON ASSUMÉE
Malgré l’établissement de sa responsabilité dans l’affaire PIP, l’ANSM n’a jamais véritablement assumé ses défaillances. L’agence a préféré mettre en avant les réformes de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux plutôt que de reconnaître ses propres manquements dans la surveillance de PIP.
Cette attitude défensive illustre une culture institutionnelle réfractaire à l’autocritique et à la remise en cause, pourtant indispensables pour prévenir la répétition de telles catastrophes sanitaires.
V. L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : FINANCEUR ET BÉNÉFICIAIRE DU SYSTÈME
A. DES LIENS FINANCIERS MASSIFS
L’analyse des déclarations publiques d’intérêts révèle l’ampleur des liens financiers entre les experts de l’ANSM et l’industrie pharmaceutique. En 2021, les experts de l’agence ont déclaré avoir perçu 156 millions d’euros de revenus de la part des laboratoires pharmaceutiques.
Ces rémunérations prennent diverses formes : honoraires de conseil, financement de recherches, invitations à des congrès, participation à des conseils scientifiques, ou encore détention d’actions et de stock-options. Cette diversité des liens financiers rend particulièrement difficile l’évaluation objective de l’indépendance des experts.
B. LES « GROS CLIENTS » DE L’EXPERTISE
Certains laboratoires pharmaceutiques se distinguent par l’ampleur de leurs liens financiers avec les experts de l’ANSM. Sanofi, Pfizer, Novartis, Roche et Johnson & Johnson figurent parmi les plus gros « clients » de l’expertise française, cumulant des centaines de liens d’intérêts avec les membres des commissions de l’agence.
Cette concentration des liens financiers autour de quelques grands laboratoires soulève des questions sur l’indépendance de l’évaluation de leurs produits. Comment un expert peut-il évaluer objectivement un médicament lorsqu’il perçoit des honoraires substantiels du laboratoire qui le commercialise ?
TOP 5 DES LABORATOIRES FINANÇANT LES EXPERTS ANSM (2021) :
• Sanofi : 18,2 millions d’euros
• Pfizer : 12,7 millions d’euros
• Novartis : 11,3 millions d’euros
• Roche : 9,8 millions d’euros
• Johnson & Johnson : 8,5 millions d’euros
C. UN SYSTÈME D’INFLUENCE MULTIFORME
L’influence de l’industrie pharmaceutique sur l’ANSM ne se limite pas aux seuls liens financiers avec les experts. Les laboratoires déploient des stratégies d’influence multiformes : financement d’études cliniques, organisation de congrès scientifiques, création de sociétés savantes, ou encore recrutement d’anciens cadres de l’agence.
Cette influence systémique contribue à créer un environnement intellectuel favorable aux intérêts de l’industrie, où les bénéfices des médicaments sont systématiquement surévalués et leurs risques minimisés. Cette distorsion cognitive a des conséquences dramatiques sur la qualité des décisions de santé publique.
VI. VACCINS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS : L’EXEMPLE DE LA CRISE COVID-19
A. DES EXPERTS COMPROMIS AUX COMMANDES
La crise de la COVID-19 a révélé de nouveaux aspects préoccupants des conflits d’intérêts à l’ANSM. Plusieurs experts impliqués dans l’évaluation des vaccins contre la COVID-19 entretenaient des liens financiers directs avec les laboratoires pharmaceutiques producteurs de ces vaccins.
Le professeur Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, déclarait ainsi des liens d’intérêts avec Pfizer, Sanofi et Johnson & Johnson, trois des principaux producteurs de vaccins contre la COVID-19. Cette situation a alimenté les soupçons sur l’indépendance des décisions prises pendant la crise sanitaire.
B. L’OPACITÉ DES PROCESSUS D’AUTORISATION
L’autorisation en urgence des vaccins contre la COVID-19 s’est déroulée dans une opacité totale, sans que le public puisse connaître l’identité des experts impliqués dans l’évaluation ni leurs éventuels conflits d’intérêts. Cette opacité contraste avec les exigences de transparence affichées par l’ANSM.
Les données d’efficacité et de sécurité des vaccins fournies par les laboratoires n’ont pas fait l’objet d’une expertise indépendante approfondie. L’ANSM s’est largement contentée de valider les analyses des industriels, soulevant des questions sur la qualité de l’évaluation réglementaire.
C. DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUS-SURVEILLÉS
La surveillance des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 révèle les limites du système de pharmacovigilance français. Malgré les signalements répétés de certains effets indésirables graves, l’ANSM a tardé à reconnaître leur lien avec la vaccination, privilégiant une communication rassurante plutôt qu’une analyse objective des risques.
Cette approche, probablement influencée par les enjeux politiques et commerciaux considérables de la vaccination de masse, illustre la difficulté pour l’ANSM de maintenir son indépendance face aux pressions multiples qu’elle subit.
VII. LE SYSTÈME DES DÉCLARATIONS PUBLIQUES D’INTÉRÊTS : UNE TRANSPARENCE DE FAÇADE
A. DES DÉCLARATIONS INCOMPLÈTES ET TARDIVES
Le système des déclarations publiques d’intérêts (DPI), mis en place pour garantir la transparence, révèle ses nombreuses failles. Une étude de l’association Anticor réalisée en 2023 montre que 43% des experts de l’ANSM n’avaient pas mis à jour leur DPI depuis plus d’un an, et 12% n’avaient jamais publié de déclaration.
Lorsqu’elles existent, ces déclarations sont souvent incomplètes, omettant des liens financiers significatifs ou les minimisant par des formulations vagues. L’absence de contrôle systématique de la sincérité et de l’exhaustivité de ces déclarations rend le système largement inefficace.
DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DPI (ÉTUDE ANTICOR 2023) :
• 43% des experts n’ont pas mis à jour leur DPI depuis un an
• 12% n’ont jamais publié de DPI
• 67% des DPI sont jugées incomplètes
• 0 sanction prononcée pour défaut de déclaration
B. L’ABSENCE DE SANCTIONS
Plus préoccupant encore, l’ANSM ne prononce aucune sanction contre les experts qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives. Cette impunité de fait encourage les comportements de dissimulation et rend le système de transparence largement théorique.
Contrairement à d’autres pays comme les États-Unis, où la violation des obligations déclaratives peut entraîner des sanctions pénales lourdes, la France a opté pour un système purement déclaratif sans mécanisme de contrôle ni sanction effective.
C. UNE GESTION DÉFAILLANTE PAR L’ANSM
L’ANSM elle-même contribue aux dysfonctionnements du système DPI. L’agence ne dispose pas d’un service dédié à la vérification des déclarations, se contentant d’une approche passive consistant à publier les déclarations transmises par les experts sans en vérifier la sincérité.
Cette approche minimaliste contraste avec les enjeux considérables de la transparence dans le domaine de la santé publique. Elle révèle une conception pour le moins restrictive de la mission de l’agence en matière de prévention des conflits d’intérêts.
VIII. LES « PORTES TOURNANTES » : QUAND L’ANSM DEVIENT UN TREMPLIN VERS L’INDUSTRIE
A. UN PHÉNOMÈNE SYSTÉMIQUE
Le phénomène des « portes tournantes » entre l’ANSM et l’industrie pharmaceutique constitue une source majeure de conflits d’intérêts. De nombreux cadres de l’agence rejoignent l’industrie pharmaceutique après leur passage dans l’administration, emportant avec eux leur connaissance des rouages réglementaires et leurs réseaux professionnels.
Cette circulation des élites entre secteur public et privé crée des connivences dangereuses pour l’indépendance de la régulation. Les décisions prises au sein de l’ANSM peuvent être influencées par les perspectives de carrière offertes par l’industrie pharmaceutique.
B. DES EXEMPLES COMPROMETTANTS
Plusieurs exemples illustrent ce phénomène préoccupant. Dominique Maraninchi, ancien directeur général de l’ANSM, a rejoint le conseil d’administration de Transgene, entreprise de biotechnologie, quelques mois seulement après avoir quitté l’agence. Cette transition rapide soulève des questions sur les décisions prises pendant son mandat.
De même, plusieurs chefs de service de l’ANSM ont rejoint des laboratoires pharmaceutiques dans des fonctions de direction des affaires réglementaires, mettant leur expertise au service d’entreprises qu’ils étaient chargés de contrôler quelques mois auparavant.
C. L’INSUFFISANCE DES GARDE-FOUS
Les garde-fous censés prévenir ces conflits d’intérêts sont largement insuffisants. La Commission de déontologie de la fonction publique, chargée d’examiner les projets de reconversion des fonctionnaires, se contente souvent de recommandations non contraignantes qui ne remettent jamais en cause les projets de reconversion.
Le délai de viduité de trois ans prévu par la loi est également insuffisant et mal contrôlé. De nombreux anciens cadres de l’ANSM exercent des activités de conseil ou de lobbying pour le compte de laboratoires pharmaceutiques sans que ces activités soient détectées et sanctionnées.
IX. IMPACT SUR LA CONFIANCE PUBLIQUE ET LA SANTÉ DES PATIENTS
A. UNE DÉFIANCE CROISSANTE DU PUBLIC
Les révélations successives sur les conflits d’intérêts à l’ANSM contribuent à éroder la confiance du public dans l’agence du médicament. Cette défiance s’est particulièrement manifestée pendant la crise de la COVID-19, où une partie significative de la population a remis en question les recommandations sanitaires officielles.
Selon un sondage Ifop réalisé en 2023, seulement 34% des Français font confiance à l’ANSM pour évaluer objectivement les médicaments. Cette défiance massive constitue un problème majeur de santé publique, car elle peut conduire à des comportements dangereux comme l’automédication ou le refus de traitements nécessaires.
CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ANSM (SONDAGE IFOP 2023) :
• 34% font confiance à l’ANSM
• 51% se méfient de l’agence
• 15% sans opinion
• 78% estiment que l’ANSM est influencée par l’industrie
B. DES CONSÉQUENCES SANITAIRES MAJEURES
Cette crise de confiance a des conséquences concrètes sur la santé publique. La défiance envers l’ANSM alimente les théories conspirationnistes et peut conduire des patients à refuser des traitements bénéfiques ou à se tourner vers des thérapies alternatives non validées scientifiquement.
Paradoxalement, la compromission de l’ANSM avec l’industrie pharmaceutique peut ainsi nuire à l’accès aux soins et à l’observance thérapeutique, deux enjeux majeurs de santé publique. Cette situation illustre parfaitement les dégâts collatéraux des conflits d’intérêts dans le domaine de la santé.
C. UN CERCLE VICIEUX DE LA DÉFIANCE
L’ANSM se trouve prise dans un cercle vicieux de la défiance. Plus l’agence est critiquée pour ses liens avec l’industrie, plus elle adopte une posture défensive qui l’éloigne du public et alimente les soupçons. Cette spirale négative compromet durablement la légitimité de l’institution.
Face à cette crise de confiance, l’ANSM privilégie souvent la communication plutôt que les réformes de fond. Cette approche cosmétique ne fait qu’aggraver le problème en donnant l’impression que l’agence refuse de reconnaître ses défaillances structurelles.
X. CONCLUSION : L’URGENCE D’UNE RÉFORME RADICALE
A. UN CONSTAT ACCABLANT
Dix ans après sa création, l’ANSM n’a pas réussi à se défaire des tares qui avaient conduit aux scandales de l’Afssaps. L’agence reste prisonnière d’un modèle de fonctionnement qui institutionnalise les conflits d’intérêts et compromet son indépendance face à l’industrie pharmaceutique.
Les révélations successives sur les liens financiers entre experts et laboratoires, les défaillances du système de transparence, et les phénomènes de portes tournantes dessinent le portrait d’une institution publique largement capturée par les intérêts privés qu’elle est censée réguler.
B. L’IMPÉRATIF D’UNE RÉFORME STRUCTURELLE
Face à l’ampleur des dysfonctionnements révélés, seule une réforme structurelle de l’ANSM peut permettre de restaurer sa crédibilité et son efficacité. Cette réforme doit passer par plusieurs mesures radicales : création d’un corps d’experts publics rémunérés par l’État, interdiction pure et simple des liens financiers avec l’industrie pour les experts participant aux évaluations, et renforcement drastique des sanctions en cas de violation des obligations déclaratives.
Il est également indispensable de mettre fin aux phénomènes de portes tournantes en instaurant un délai de viduité de dix ans et en créant une autorité indépendante chargée de contrôler effectivement le respect de ces interdictions. Sans ces réformes radicales, l’ANSM continuera d’être un instrument au service de l’industrie pharmaceutique plutôt qu’un véritable gardien de la santé publique.
C. UN ENJEU DÉMOCRATIQUE MAJEUR
Au-delà des aspects techniques, la réforme de l’ANSM constitue un enjeu démocratique majeur. Dans une société où les questions de santé occupent une place centrale, il est inacceptable que les décisions qui engagent la vie et la santé des citoyens soient prises par des experts compromis avec l’industrie pharmaceutique.
« Une agence du médicament indépendante n’est pas un luxe, c’est une nécessité démocratique. La santé publique ne peut être subordonnée aux intérêts commerciaux des laboratoires pharmaceutiques. »
Dr. Philippe Foucras, président de Formindep
La France dispose des compétences scientifiques et des moyens financiers nécessaires pour créer une véritable agence du médicament indépendante. Il ne manque que la volonté politique de rompre avec un système qui privilégie les intérêts privés au détriment de la santé publique. L’urgence sanitaire et démocratique commande d’agir sans délai pour restaurer l’intégrité de cette institution cruciale pour la santé des Français.
